Acouphènes et émotions :
L’acouphène serait-il un phénomène purement physiologique ? La part liée au subjectif et aux émotions pèserait-elle plus qu’on ne le pense ? Lors du 10e colloque de l’Association francophone des équipes pluridisciplinaires en acouphénologie (Afrépa), qui s’est tenu à Nancy les 6 et 7 septembre 2019, des experts ont apporté des éclairages intéressants et novateurs, notamment à travers l’imagerie cérébrale.
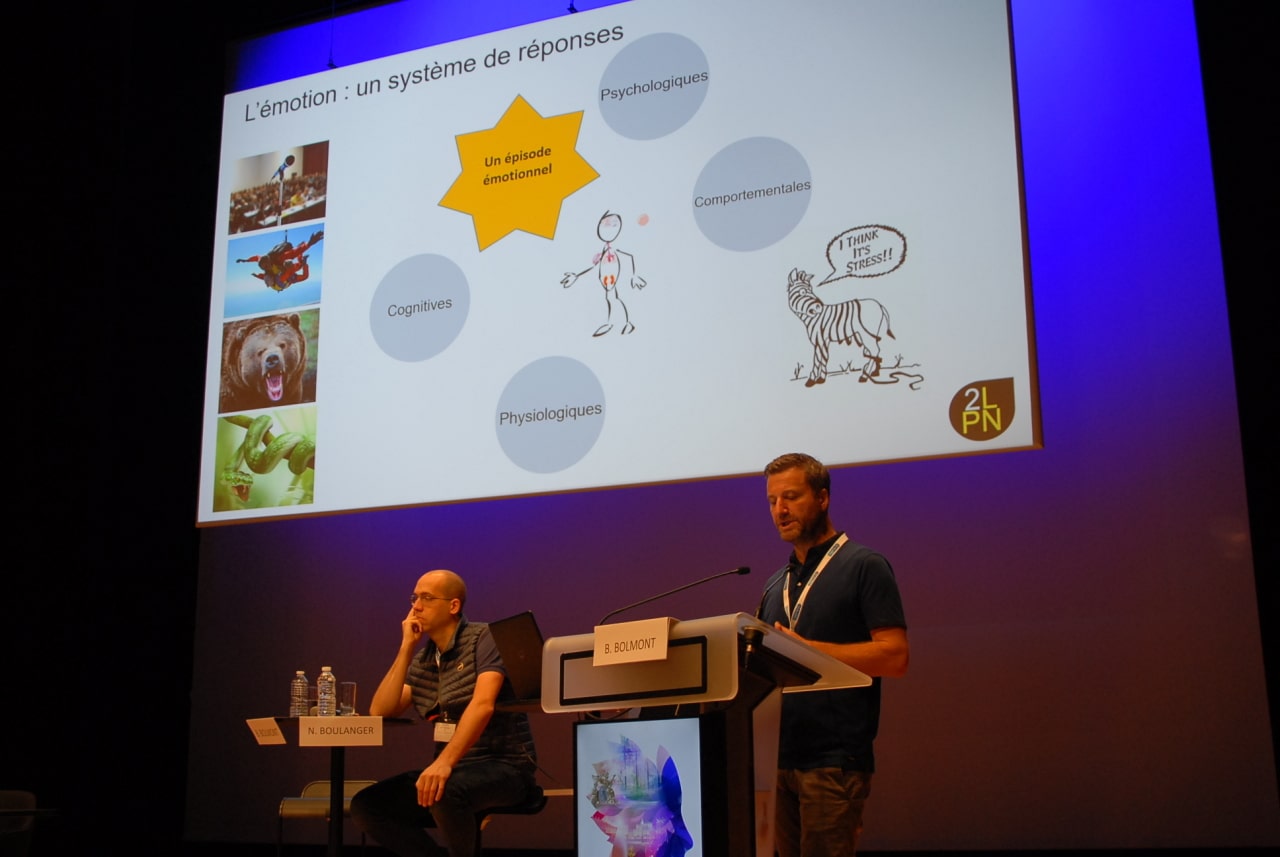
Le professeur Bolmont décrypte la relation entre acouphènes et émotions.
« Globalement, les acouphéniques sont plus anxieux et plus dépressifs que la moyenne de la population »
«L’acouphène a-t-il une origine physiologique ou psychologique ? » Le Pr Benoît Bolmont, enseignant-chercheur à l’université de Lorraine, démarre sa présentation par la question qui est au cœur du débat : le chercheur a analysé une soixantaine d’études parues au cours des 25 dernières années. « Globalement, les acouphéniques sont plus anxieux et plus dépressifs que la moyenne de la population », indique Benoît Bolmont. 50 à 90 % des patients acouphéniques seraient dépressifs. On observe une relation entre l’intensité de l’acouphène et l’anxiété. Le système limbique – siège des émotions – est impliqué.
L’acouphène est souvent consécutif à un événement stressant ou un trauma émotionnel. Aussi, « si l’acouphène est physiologique, il pourrait quand même avoir une origine psychologique », module le chercheur en réponse à sa question initiale.
Conclusions de l’analyse qu’il a réalisé sur les différentes études : l’acouphène entraîne une modification de l’état psychologique qui influe sur son intensité mais, à l’inverse, des modifications psychologiques pourraient déclencher un acouphène probablement préexistant. « Il existe des susceptibilités génétiques. L’anxiété, la dépression, certains traits de personnalité pourraient constituer des facteurs de vulnérabilité », relève le chercheur.
Accompagnement psycho-affectif
Logiquement, une table ronde regroupant plusieurs praticiens évoquant l’accompagnement psycho-affectif des patients a conclu cette séance plénière. Pour le Dr Anne Guillemot-Lacour, psychiatre libéral et membre de l’équipe pluridisciplinaire de Nancy, « l’acouphène n’est pas un symptôme psychiatrique, mais son mode d’expression peut témoigner d’une pathologie psychiatrique ». Le rôle du médecin est d’évaluer un éventuel état dépressif et de traiter celui-ci. Mais la prescription d’antidépresseurs n’est pas simple dans la mesure où ces médicaments peuvent engendrer des acouphènes… De plus, ces prescriptions doivent être accompagnées d’entretiens de psychothérapie. « L’objectif est d’amener le patient à l’acceptation de l’acouphène », fait remarquer le Dr Guillemot-Lacour. Pour cela, les thérapies comportementales et cognitives (TCC) sont efficaces, selon Ivan Quintin, psychologue libéral : « Les TCC peuvent mener à l’orientation attentionnelle, à la relaxation, à la gestion cognitive… »
Praticienne de méditation pleine conscience et relaxation à Nancy, Catherine Frinot évoque « le nombre exponentiel d’études montrant les bienfaits de ces pratiques face aux phénomènes anxieux et dépressifs ». Pour le Dr Marc Ounnoughene, psychiatre et psychothérapeute, « la prise en charge d’un patient acouphénique associe psycho-éducation, réduction du stress et, enfin, habituation ».
Toutefois, il faut éviter certains pièges, comme celui d’entraîner dans une thérapie comportementale un patient souffrant d’un neurinome acoustique non diagnostiqué. Autre écueil à éviter : les patients psychotiques, pour lesquels ce type de thérapies est contre-indiqué, et les personnes dépressives, chez qui la dépression doit d’abord être traitée.
Modérateur de cette séance, le Dr Nicolas Boulanger, ORL à Nancy, rappelle qu’il faut proposer l’appareillage prothétique et valoriser un discours commun dans une équipe pluridisciplinaire, pour faire rempart au nomadisme médical, souvent pratiqué par les patients acouphèniques.
 Se connecter
Se connecter

