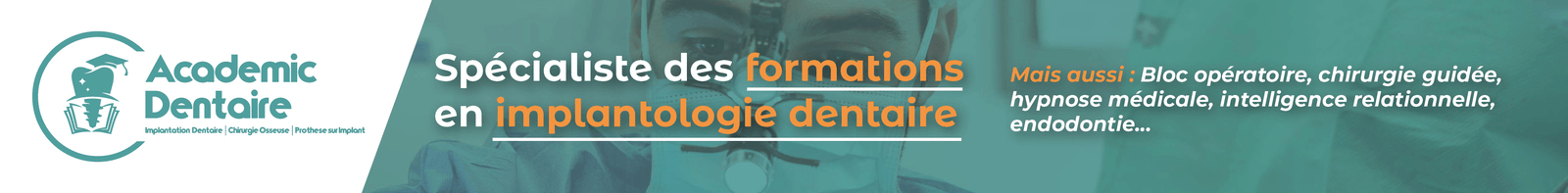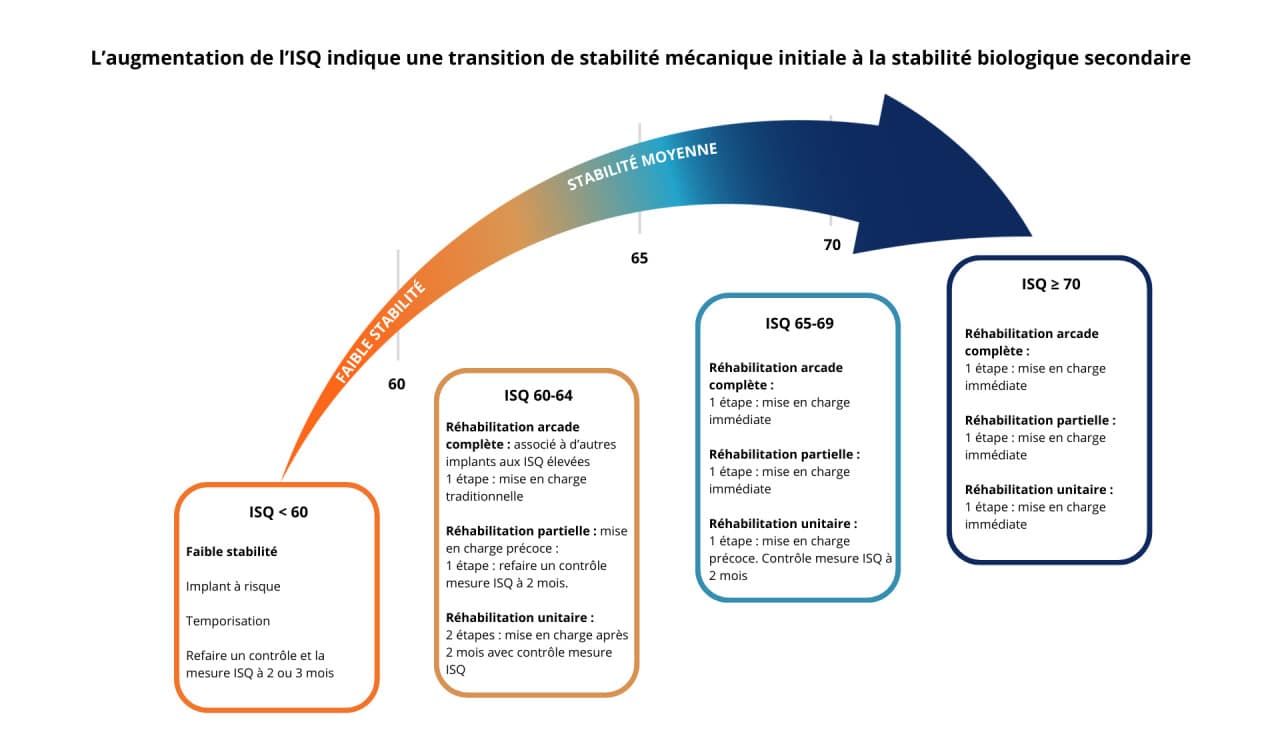Middlewares,au-delà du flux de production
L'informatique de gestion du laboratoire est passée en quelques années des middlewares chargés d'interopérer des automates avec quelques règles d'expertise à des outils de business intelligence utilisant des algorithmes poussés : des fonctionnalités et des évolutions techniques dans lesquelles les biologistes se plongent avec prudence et enthousiasme !

Installation, migration, maintenance, mises à jour... les opérations informatiques dans le laboratoire doivent être préparées soigneusement pour perturber le moins possible la production.
Jusqu’à récemment, le terme de middleware apparaissait dès qu’une solution informatique accompagnait un automate ou faisait la liaison entre deux outils du laboratoire, recouvrant parfois des réalités très différentes. Après un franc succès, le mot tend à être remplacé par des termes évoquant ses fonctionnalités (pilotage, gestion, data management) plutôt que sa place dans une chaine informatique.
Cette transformation est confirmée par Christine Lelièvre, directrice marketing et communication chez BYG4lab : « Le terme « middleware » est devenu trop générique et ne reflète plus notre métier de manière adéquate. Chez BYG4lab, nous préférons parler de data management ou de système expert de management de la production et de la qualité. Nos solutions vont bien au-delà de simples outils d’interopérabilité entre deux systèmes, en répondant à des besoins complexes, tels que la gestion en temps réel d’une volumétrie considérable, l’intégrité et la sécurité des données, et l’amélioration de l’efficience opérationnelle des laboratoires. »
Des origines à nos jours
Besoins fondamentaux
Le rôle d’un middleware est de définir des règles d’expertise qui vont permettre des autovalidations et des redirections pour optimiser les flux. « Cette gestion et cette automatisation des flux s’inscrivent dans un contexte de réduction de personnel pour plus d’échantillons sur plus d’automates de grande diversité – tout en gardant à l’esprit que l’on travaille pour l’amélioration des soins aux patients », rappelle Virginie Ledoigt-Lemonier, responsable commerciale France de Data Innovations.
Un héritage repensé
La plupart des éditeurs ont hérité de solutions dont les socles techniques ont plus de 10 ans et nécessitent des mises à jour profondes ; un travail qui s’accompagne souvent d’une nouvelle image de marque, d’une nouvelle conception de la commercialisation ou de l’hébergement des solutions. « C’est pourquoi les différentes solutions de BYG4lab ont désormais un socle technique commun baptisé Yline®, affirme Christelle Lelièvre. Cette architecture technique de dernière génération nous permet indéniablement de répondre aux exigences actuelles des systèmes d’information, garantissant évolutivité, sécurité et maintenabilité. »
Le secteur s’est concentré, d’anciennes solutions ont été rachetées et, aujourd’hui, les éditeurs font, petit à petit, converger leurs clients vers une solution unique, comme chez Data Innovations : « Nous avons encore de nombreux utilisateurs de notre middleware LPM, illustre Virginie Ledoigt-Lemonier. Nous leur proposons aujourd’hui Instrument Manager, solution qui continue d’évoluer et sur laquelle nous avons, par exemple, retravaillé entièrement la base de données pour améliorer la sécurité. Ainsi, nous avons choisi de rester sur InterSystems, mais avec leur dernière évolution, Iris. »
Évolutions des besoins
« Bien sûr, les clients continuent de vouloir les fonctions classiques d’un middleware (gestion et optimisation des flux), mais ils veulent aussi des options avancées et des modules spécifiques, explique la responsable commerciale de Data Innovations. Ils sont devenus exigeants quant à la cybersécurité et à la disponibilité : il faut pouvoir pallier les indisponibilités du SIL du laboratoire – s’il tombe pour quelque raison que ce soit, le laboratoire doit pouvoir continuer à travailler par un passage en mode dégradé. »
Les évolutions techniques
« Saas » ou « on premise »
« Autant, pour le SIL, les laboratoires sont maintenant très ouverts à une solution de type Saas, autant, pour le middleware, il y a encore beaucoup de réticences, témoigne François Vasseur, directeur de la division biologie du groupe Softway Medical. L’avantage, quand l’éditeur est l’unique interlocuteur, c’est que, si nous changeons l’architecture de la solution informatique, nous nous assurons nous-mêmes que le serveur suit. Ce n’est plus à la charge du laboratoire. »
Cette tendance est confirmée par Pierre Mezeray, directeur exécutif Solutions diagnostiques et Transformation en santé, chez Roche Diagnostics France : « Depuis maintenant 5 à 10 ans, les clients ont quand même l’habitude des solutions cloud modulaires avec des souscriptions de modules à la demande. C’est une option technique qui simplifie la disponibilité, la maintenance et la sécurité. »
Choisir son hébergement
« Le fait que nous soyons à la fois hébergeur, opérateur de communication et éditeur nous permet de garantir le fonctionnement de toute la chaine. C’est un engagement total vis-à-vis de nos clients. Cela signifie aussi que nous nous devons de lui assurer une disponibilité totale », insiste François Vasseur.
Les autres éditeurs choisissent parfois de nouer des partenariats avec des hébergeurs (AWS pour Dedalus, par exemple) ou de se poser simplement en conseil de leur client sur ce point. « Il faut, bien sûr, que l’hébergeur soit certifié HDS, explique Coralie Carron, responsable Stratégie produits chez Clarysis, mais il y a d’autres paramètres techniques à envisager pour bâtir une architecture adaptée au laboratoire et anticiper les évolutions, normatives et autres, à venir. Tous les hébergeurs ne sont pas égaux face aux exigences de la biologie. Prendre conseil est essentiel. »
Une standardisation qui a ouvert les connexions
« Des standards d’interopérabilité tels que HL7 (international) et Hprim (français) coexistent pour les échanges de données de santé, poursuit Coralie Carron, bien que les connexions automates tendent à se normaliser vers du HL7. La mise en place du Ségur harmonise les pratiques des laboratoires, mais, de fait, impose une standardisation des éditeurs et fournisseurs d’interopérabilité. Cependant, il va se passer encore de longues années avant que la diversité qui existe aujourd’hui sur les automates ne s’estompe. Il est donc essentiel de pouvoir développer les drivers nécessaires à la demande pour pouvoir s’interconnecter. C’est tout l’avantage d’un middleware agnostique : s’interfacer à tout logiciel et tout automate du marché. Nous pouvons installer notre solution middleware en direct ou bien nous mettre en boite noire pour faciliter les connexions déjà en place et permettre l’échange de données patient. C’est le laboratoire qui décide de ces choix stratégiques ; à nous d’être à l’écoute de nos clients et d’apporter notre expertise et nos conseils pour les accompagner dans leurs choix en leur expliquant les implications techniques de ceux-ci. »
Agnostique ou non, est-ce encore une question ?
Réponse : beaucoup moins qu’avant, c’est certain. En effet, si les éditeurs agnostiques font valoir leur universalité de fait, les fournisseurs d’automate ont aussi des arguments de poids (et une indéniable force de vente). Choisir tel ou tel éditeur, agnostique ou non, représente un choix stratégique qui incombe aux laboratoires en fonction de très nombreux critères.
MAS_EXERGUE_PHOTO_LEGENDE (~ 200 signes)
« En tant qu’éditeur et intégrateur, nous nous devons de nous adapter, affirme Virginie Ledoigt-Lemonier. Notre force, chez Data Innovations, c’est l’universalité. Nous pouvons prouver que nous sommes installés au sein de plus de 6 000 laboratoires dans plus de 85 pays et nous avons un tel panel de drivers (plus de 1 100 au catalogue) et de fonctionnalités que nous avons déjà fait les développements pour répondre à la plupart des demandes, mais cela ne nous freine pas, au contraire, sur le chemin de l’innovation. »
À l’inverse, Abbott, par exemple, reconnait ouvertement : « Nous préférons installer nos solutions sur notre parc machine. Nous travaillons avec de nombreux partenaires sur lesquels nous venons nous connecter et AliniQ AMS, notre middleware phare, prend en charge plus de 863 instruments. »
Quant à Roche, Pierre Mezeray explique : « Nos solutions logicielles sont développées dans une entité à part qui fonctionne comme un éditeur indépendant. Que les automates soient Roche ou non ne nous empêche pas de nous déployer. »
MAS_EXERGUE_PHOTO_LEGENDE (~ 200 signes)
Les évolutions fonctionnelles
Passé certains choix techniques, liés à la sécurité, à la maintenance, à la disponibilité et à la fluidité des données, les éditeurs cherchent à présent à se différencier par les fonctionnalités qu’ils vont proposer. Certains visent une certaine exhaustivité de leur catalogue, quand d’autres vont aller au plus près du terrain, pour faire remonter les besoins réels les plus courants. Dans tous les cas, les stratégies de développement doivent répondre de manière très experte aux attentes des biologistes et des techniciens. On retrouve une logique d’UX Design chez tous les acteurs : « C’est au cœur de notre travail pour repenser nos solutions », pointe François Vasseur pour Softway Medical ; la force de l’expérience fait foi chez Dedalus, dont le directeur général France, Guillem Pelissier, a déclaré : « C’est bien d’avoir des produits performants, mais il faut qu’ils soient utiles et utilisables. Nous travaillons donc désormais en coconstruction pour coller au mieux aux préoccupations et aux pratiques de nos utilisateurs. »
Des solutions expertes
Pour les éditeurs de biologie, il faut donc non seulement connaitre les habitudes de ses clients, mais aussi être experts dans leurs métiers, selon Christelle Lelièvre de BYG4lab : « Nos solutions couvrent un large spectre de disciplines biologiques, nécessitant une connaissance profonde de toutes les spécialités pour fournir aux biologistes les outils dont ils ont besoin. Cela inclut également des spécialités, telles que la gestion et la validation des plaques en toxicologie ou biologie moléculaire, ou encore l’interprétation des courbes d’électrophorèse, où nous pouvons ajouter des pics ou modifier des fragments. Nous gérons également la biologie délocalisée avec ses contraintes règlementaires et sommes aussi présents au-delà du laboratoire, en contribuant à des enjeux de santé publique avec notre système d’épidémiologie et de surveillance des infections associées aux soins. »
La qualité occupe une place centrale
« Aujourd’hui, la notion de middleware a beaucoup évolué, en conjonction avec les besoins grandissant des laboratoires, aussi bien dans la gestion des échantillons que dans la gestion de la qualité », confirme Pierre Mezeray, de Roche Diagnostics France, qui complète en expliquant que, devant cette préoccupation de qualité, « nous avons fait le choix, sur la partie middleware, d’une couche unique pour la gestion des patients, du workflow et des contrôles de qualité. Ce choix permet de réduire les couches critiques et garantit un pilotage des chaines intelligent tenant compte à la fois des informations remontant des instruments (réactif à bord, module disponible, etc.) et à la fois des informations liées aux contrôles de qualité ou aux moyennes mobiles. En outre, pour répondre aux exigences de qualité indispensables au fonctionnement d’un laboratoire, l’intégration dans la même solution des fonctionnalités de contrôle qualité et des résultats patient permet de garantir le lien et de pouvoir automatiser les études d’impact lorsqu’un contrôle de qualité dépasse les objectifs d’impact clinique. »
MAS_EXERGUE_PHOTO_LEGENDE (~ 200 signes)
Couvrir toutes les paillasses
Pour les éditeurs généralistes, c’est une tendance évidente : il faut pouvoir avoir une offre qui couvre toutes les paillasses. Les éditeurs historiquement consacrés à la microbiologie développent donc des solutions généralistes, comme Softway Medical Biologie qui a développé le logiciel Mydisia Manager, une version étendue du middleware Mydisia spécialisé dans la microbiologie et qui pourra couvrir l’ensemble du laboratoire : « Actuellement en phase pilote, nous pensons commercialiser officiellement cette solution à compter de l’été 2025 », détaille François Vasseur.
En outre, les offres se construisent désormais par fonctionnalités et non plus par paillasses – hormis la microbiologie, qui reste à part. Des fonctionnalités que le laboratoire peut implémenter à la carte, comme l’illustre Pierre Mezeray, de Roche Diagnostics France : « Navify Diagnostics portfolio est une suite modulaire composée du middleware navify Lab Operations et d’une vingtaine de solutions qui vont de l’efficience opérationnelle du labo jusqu’à la gestion fine des données pour améliorer la prise en charge du patient. »
Ces constructions modulaires peuvent maintenant être retrouvées presque partout, mais elles rendent d’autant plus compliqués certains arbitrages, car il faut comprendre les briques dont le laboratoire aura ou non besoin pour évaluer la facture finale et faire une comparaison éclairée avec les concurrents !
MAS_EXERGUE_PHOTO_LEGENDE (~ 200 signes)
Des suites logicielles complètes
Chez les éditeurs, qu’ils soient agnostiques ou non, les middlewares s’inscrivent désormais dans des suites logicielles qui cherchent à couvrir l’ensemble des besoins des laboratoires ou des établissements. Chez Dedalus, par exemple, c’est un très grand chantier, en raison de l’histoire de l’entreprise qui s’est construite avec l’acquisition de nombreuses solutions logicielles existantes. Ce chantier, baptisé « convergence des solutions », passe par la migration et la mise à jour des outils installés chez les clients vers de nouveaux outils inter- opérables, sécurisés et aux fonctionnalités avancées. Frédéric Poirier, Business Manager In-Vitro Diagnostic, explique ainsi : « La suite convergée InVitro LIS de Dedalus repose sur le noyau KaliSil, le système de management de la qualité KaliLab et des modules créateurs de valeur : solutions de facturation, portails de résultats et pilotage du plateau technique autour du middleware généraliste Halia qui intègre la gestion de l’INS et propose une interface intuitive pour une expérience utilisateur optimisée. »
Les stratégies de développement pour offrir au client une solution complète varient d’un éditeur à l’autre. Si Dedalus mise sur la construction d’un écosystème de partenaires, Abbott, de son côté, fort de l’assise d’un grand groupe mondial, propose, sous sa marque Abbott AlinIQ Digital Health Solutions (DHS), un système entièrement intégré qui couvre toutes les étapes, de l’aide au prescripteur jusqu’à l’orientation diagnostique. Toutefois, en France, de telles solutions sont aujourd’hui difficiles à implanter, car les autres acteurs de la chaine ne sont pas tous informatisés.
Mettre le labo au cœur de l’écosystème de santé
En effet, BYG4lab, par l’intermédiaire de Christelle Lelièvre, souligne que les données du laboratoire sont à la base de la prise en charge du patient. Leur agrégation ou leurs mises en perspective au niveau individuel ou collectif peuvent apporter des informations à la gestion de l’écosystème de santé en général.
Génération de biomarqueurs complexes
Pierre Mezeray développe : « Aujourd’hui, les laboratoires génèrent et centralisent un grand nombre de données difficilement exploitées. Grâce aux avancées en intelligence artificielle [IA], ces données peuvent être désormais massivement utilisées par d’autres applications. Roche combine ainsi des résultats de tests sur les instruments et des algorithmes avancés pour produire, sur certaines applications de son portfolio, des indicateurs permettant d’améliorer la prise en charge du patient. »
MAS_EXERGUE_PHOTO_LEGENDE (~ 200 signes)
De l’IA à tous les étages
La puissance de calcul, de prédiction et d’automatisation des IA permet de transformer toutes les étapes du flux en données. Des systèmes experts peuvent ainsi être implémentés à tous les stades des processus : aide à la décision, prétri, génération de compte rendu automatisé, analyses complémentaires, etc. Tous les éditeurs, petits et gros, travaillent donc à développer des fonctionnalités avancées propulsées par l’IA, soit par le biais d’une ressource R&D interne, soit par des partenariats avec des entreprises spécialisées.
« Les progrès des technologies de l’information stimulent la transformation numérique des laboratoires cliniques », souligne le représentant d’Abbott. Cloud, IA, Internet des objets ou encore télémédecine, « ces outils devraient aider les laboratoires de biologie médicale à passer du statut de simples producteurs de résultats de tests à celui d’acteurs clés du parcours de soins. »
Les spécificités de la microbiologie
La paillasse de microbiologie reste bien souvent physiquement à part et avec un fonctionnement où les manipulations et les saisies manuelles sont encore monnaie courante. Pourtant, l’automatisation s’y développe et, avec elle, la dématérialisation des données aussi. Les mêmes tendances que pour les autres paillasses commencent à émerger.
Une numérisation par l’amont
La numérisation en microbiologie commence en amont du middleware ou du SIL, par la saisie des données sur des terminaux mobiles. À ce niveau, on peut compter sur un opérateur historique comme 3SI et sa solution Scan’Bac Paperless qui va d’ailleurs céder sa place à la solution 100 % Internet Labow à partir de l’été 2025. Cependant, d’autres acteurs s’intéressent désormais à ce segment amont, comme Clarysis et sa solution Bac’Express, extension du middleware généraliste MCA, développé spécialement pour la bactériologie. « La nouvelle version de Bac’Express, sortie en fin 2024, proposant une nouvelle ergonomie et des innovations fonctionnelles, assoit Clarisys dans sa couverture de l’ensemble des paillasses grâce à ses middlewares », précise Coralie Carron.
Softway Medical Biologie, de son côté, propose une offre de saisie numérique, Mydisia One, « qui permet d’entamer la dématérialisation de la saisie des formulaires sur la paillasse de microbiologie sur tous types de terminaux mobiles », précise François Vasseur, directeur de la division biologie du groupe Softway Medical.
Nouvelles fonctionnalités
Pour en revenir au niveau du middleware et des données, les développements se poursuivent aussi en microbiologie. François Vasseur poursuit son explication : « Nous continuons de faire évoluer Mydisia. Par exemple, nous avons intégré, fin 2024, les règles de conformité CA-SFM pour la validation des antibiogrammes. Avant que ce module ne soit disponible, les biologistes devaient créer manuellement les règles. Ils se limitaient donc généralement aux principales. Désormais, s’ils ont choisi ce module, les règles sont déjà implémentées et les mises à jour sont intégrées dès qu’elles sont disponibles. »
Au cœur de la donnée
On retrouve, en microbiologie, les mêmes besoins de circulation des données qu’ailleurs : « Aujourd’hui, elles ne doivent plus seulement circuler au sein du laboratoire, pour optimiser son propre fonctionnement, mais aussi à l’extérieur, pour la prise en charge globale du patient, développe Marc Bonnet, directeur digital en santé de bioMérieux. En développant MAESTRIA™, nous n’avons pas perdu de vue la finalité du diagnostic, qui reste la prise en charge du patient. C’est pourquoi, par exemple, nous avons axé notre recherche pour rendre les résultats au plus vite, un point crucial dans le traitement des maladies infectieuses, comme le sepsis. Et en toute logique, le middleware ne pouvait pas continuer à vivre tout seul ; il constitue donc une brique d’une suite logicielle plus large, bioMérieux Vision Suite, sur laquelle peuvent s’appuyer de nouveaux usages, comme l’aide à la décision, d’une part, des infectiologues contre l’antibiorésistance et, d’autre part, des hygiénistes contre les maladies nosocomiales. »
Interopérabilité et sécurité
D’un point de vue technique, « standardisation, interopérabilité et sécurité » est aussi le triptyque gagnant. « Pour être efficaces, ces logiciels doivent être bidirectionnels, poursuit Marc Bonnet. Nous les avons donc construits sur la base du vocabulaire LOINC recommandé par le Ségur du numérique en santé et dans le respect de la norme HL7 sur tous les flux afin de largement faciliter l’interopérabilité. Enfin, MAESTRIA™ est certifié UL2900, norme très exigeante en matière de cybersécurité qui assure la conformité du produit, mais aussi de tous les tests réalisés, pour obtenir et garder sa certification. »
L’ère des données
Derrière les nouvelles fonctionnalités, l’implémentation d’outils à base d’IA et la numérisation de tous les processus, on voit les éditeurs et les laboratoires s’intéresser à la richesse de leurs données. Comment les stocker, les structurer ? À qui et pourquoi les rendre disponibles ? Si toutes les questions éthiques et pratiques ne sont pas cadrées, les partenariats avec la recherche clinique commencent déjà à se monter et chacun, avec ses compétences et ses moyens, travaille sur la gestion des données du laboratoire.
Un autre point marquant chez tous les éditeurs rencontrés est l’investissement massif dans la R&D, tant en ressources humaines qu’en valeur financière.
Le temps long des installations
Même si les déploiements se font, comme le reste, dix à cent fois plus vite que les solutions d’il y a dix ans, il faut garder à l’esprit que changer de middlewares ou implémenter des suites logicielles nouvelles constitue un investissement financier et humain important. Aussi, entre l’annonce et la mise à disposition de fonctionnalités avancées et leur utilisation massive et réelle sur le terrain, il risque de se passer encore pas mal d’années. Pour les laboratoires, ce sont des installations de moyen à long terme qu’il faut penser avec soin, des décisions et des choix stratégiques à ne pas prendre à la légère.
Quand l’humain reprend sa place
Mais alors, comment font les laboratoires pour choisir ? Les retours d’expérience en la matière sont assez parlants : face à des solutions qui, techniquement, peuvent répondre aux besoins du labo, l’humain va largement reprendre le dessus. La relation de confiance, l’écoute et la disponibilité deviennent très vite des critères prédominants pour le choix d’un futur prestataire. Les laboratoires préfèrent parfois prendre un éditeur moins avancé technologiquement, mais capable de s’adapter à leurs spécificités, pariant sur une capacité de développement à venir qui, d’ailleurs, se fera peut-être de concert avec l’éditeur. Comme quoi, pour mettre de l’IA au laboratoire, il faut avant tout des qualités humaines !
 Se connecter
Se connecter